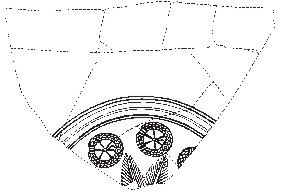|
Téléchargez le fichier PDF |
CATHMA
Compte rendu de la réunion du 7 novembre 1997
Présents : J.-M. Azorin, D. Carru, F. Coeur-Mezzoud, F. Paillard, J.-P.
Pelletier, D. Pieri, J. Piton, C. Richarté, J. et Y. Rigoir, S. Saulnier,
L. Rivet, L. Vallauri, M. Valente, B. Vasselin.
Excusés : G. Démians d’Archimbaud, J.-B. Féraud, Ph. Mellinand, J. Pournot,
C. Raynaud, M. Vecchione.
La réunion s’est tenue dans les locaux de l’IRPA, à Arles.
I. ARLES, fouilles de l’Esplanade (présentation M. Valente).
Présentation du mobilier céramique provenant des fouilles d’un quartier suburbain réalisées par G. Congès en 1973-74 en vue de la construction d’un parking : l’Esplanade. Ce matériel céramique fait actuellement l’objet d’un mémoire de DEA (sous la direction de J. Guyon). Les vestiges se rattachent à un quartier organisé à proximité du rempart augustéen. Le mobilier provient de sondages réalisés dans la maison dite “aux deux planchers” et plus particulièrement de la couche d’incendie recouvrant le deuxième plancher construit au début du IIIe s. et incendié dans la deuxième moitié du IIIe s. (monnaies de 253-270). Le secteur est définitivement abandonné vers la fin du IVe s. (G. Congès, J.-P. Brun, A. Roth-Congès, L’évolution d’un quartier suburbain à Arles, dans Provence Historique, XLII, 1992, p. 119-134).
G. Congès propose de mettre ces incendies en relation avec d’autres incendies qui ont été repérés pour les mêmes périodes (260-70) en d’autres points de la ville (G. Congès, M. Leguilloux, Un dépotoir de l’Antiquité tardive dans le quartier de l’Esplanade à Arles, dans R.A.N., 24, 1991, p. 201-234).
1. Amphores.
Les productions de Méditerranée occidentale sont dominantes : Gauloises 4 et Richborough, Dr. 23, Almagro 51, Beltrán 72 ; quelques africaines : grandes dimensions de types II C et D.
Quelques autres identifications sont problématiques : il s’agit probablement de produits originaires de Bétique, car les pâtes sont proches des Almagro 50.
2. Vaisselle.
Elle constitue un ensemble tout aussi homogène mêlant les productions régionales : B/Luisantes de la fin du IIIe s. avec, pour la B, quelques formes Desbat 20 et 34, 67, quelques rares fragments de cér. métallescente et de Sigillée gauloise tardive de Lezoux (Déch. 72) et des importations de sigillé claire C1 ou C2 (H. 45A et 50) correspondant sans doute aux premières productions qui commencent avec la diffusion des amphores tunisiennes.On note également la présence massive d’africaine de cuisine avec des pièces surtout diffusées à partir de la deuxième moitié du IIe s. (H. 181, 182, 196, 197, 23A). Les sigillées claires D correspondent au dernier quart du IIIe s. avec une forme classique en D1 de type H. 59.En ce qui concerne les communes à pâte calcaire : un fond épais d’un grand vaisseau montrant des similitudes avec la pâte des amphores gauloises.Sont également présentes les premières générations de céramiques sableuses à inclusions blanches vraisemblablement originaires du Languedoc. Une lampe est peut-être languedocienne.
II. EYGUIERES (présentation J.-P. Pelletier).
Le mobilier provient de la partie centrale de la cour trapézoïdale séparant les thermes de la pars rustica. A priori les séquences correspondent au premier état de la villa et aux reconstructions du deuxième état.
Contexte 9721 : prépondérance du mobilier de l’Age du Fer ; quelques fragments d’arétine de type ancien (Service II de Haltern).
Contexte 9701 : présence de Luisante, d’un bord de languedocienne, de sigillée claire A (H. 14A) ; fragment de cl. D (peut être contemporain du deuxième état).
Contexte 9723 : céramique grise de la vallée du Rhône, sigillée cl. B, Luisante, culinaire africaine, céramique languedocienne à engobe micacée, B noire production d’Alba. Datation proposée : fin IIIe s.
Contexte 9703 : fragment de Beltrán 2B.
Contexte 9728 : Sigillée claire B et Luisante (type Pernon 62).
Contexte 9733 : Sigillée claire C, Luisante (Lamb. 1/37), proto LRA 3.
Contexte 9726 (tranchée mur nord) : culinaire africaine, sigillée claire B et C, amphore africaine. Datation proposée : fin IIIe s.
Contexte 9718 : commune à pisolithes, amphore gauloise, LRA 1, Dr. 23. Datation proposée : fin IVe-début Ve s.
Contexte 9712 : amphore italique.
Contexte 9717 : LRA1, amphore africaine cylindrique de moyenne dimension.
III. CABRIERES D’AVIGNON (présentation J.-M. Azorin et D. Carru).
Le site (environ un hectare), à flanc de coteaux, au-dessus de la vallée du Calavon, est localisé à 10 km au n/e de Cavaillon. Le mobilier, issu de prospections pédestres, correspond à une villa romaine avec un établissement balnéaire comparable à ce que l’on connait par ailleurs dans la plaine de Gordes. Apparemment, l’occupation semble continue du Ier au XIe s. Les fondations de la villa ont été mises au jour à l’occasion de la construction d’une maison individuelle et par des travaux agricoles (les matériaux étant rejetés dans un énorme clapier). Le mobilier de la fin de l’Antiquité et du Haut Moyen Age présenté constitue 1/5e de l’ensemble prélevé.
1. Antiquité tardive.
Pour la fin de l’Antiquité, le matériel est composé de sigillée claire B (f. 18 relative aux productions de transition avec les DS. P.), de DS.P.P. (f. 1, 3a et b, 8, 18, cruche, etc.) dont les décors sont particulièrement intéressants (motif complexe rectangulaire inédit sur une assiette, palmettes, arceaux) essentiellement sur des panses. Quelques fragments de DS.P. orangées dont des formes de bol 18 à décor de rouelles. Les Luisantes sont nombreuses. Les productions africaines sont attestées par quelques fragments de sig. claire D (H. 87B à décor de croix monogramatique) ainsi que par de nombreux fragments de culinaires africaines.
Le mobilier amphorique est composé d’une majorité de fragments d’amphores africaines (Keay 61A et C, 62), quelques hispaniques (Dr 23, Almagro 51B) ; pas un seul tesson d’orientale.
2. Haut Moyen Age.
La céramique commune grise est caractérisée par plusieurs types de pâtes : rouge à surface noire (région d’Apt), bleue craquelée, etc.
Les formes fermées sont majoritaires, à bec ponté ou tubulaire, fonds bombés, anses rubannées, rebords mous, formes carénées, panses côtelées présentant parfois des décors incisés, ondés (cercles concentriques) et à la roulette (motif complexe) et plus rarement des surfaces lissées.
IV. LA CIOTAT, Calanque Saint-Pierre, Ile verte (présentation B. Vasselin).
Prospections et sondages s’inscrivent dans le programme sur le peuplement des Iles (SRA-PACA). Le site correspond à un village de pêcheurs saisonniers qui connaît deux phases de fréquentation : IIe-Ier s. av. n. è. et fin de l’Antiquité.
Dans le sondage 1, mur lié à la terre et dépotoir contenant du mobilier ATHMA.
DS.P.P. (f. 18), Sigillée claire D (H. 99, 102, 104C, 106), commune grise des environs de Marseille (f. A et B). Commune importée des îles de Pantelleria (f. CATHMA X), amphores africaine (Keay 62) et orientale LRA 1 (Syro-Palestinienne) et 1B (Gaza). Datation du contexte : fin VIe s.