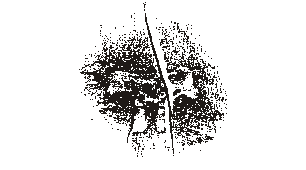|
Téléchargez le fichier PDF |
CATHMA
Compte rendu de la réunion des 19 et 20 mai 1994
à Port-Vendres
et Perpignan
Présents : M. Bonifay, L. Del’ Furia, D. Foy, J. Kotarba, I. et R. Maréchal,
Th. Martin, D. Piéry, J. et Y. Rigoir, L. Rivet, S. Saulnier.
Excusés : G. Demians d’Archimbaud, M. Leenhardt, J. -P. Pelletier, J. Piton,
C. Raynaud, L. Vallauri.
La réunion du 19 mai s’est tenue dans les locaux du Dépôt de fouilles de la D.R.A.S.M. où notre équipe a été accueillie par L. Del’ Furia ; durant l’après-midi a été vu l’ensemble du matériel de Port-Vendres I. Le lendemain, la matinée s’est déroulée pour partie à Ruscino, sous la conduite par R. Maréchal et, à Perpignan, au Dépôt de fouilles Départemental, sous la conduite de J. Kotarba.
LE MOBILIER DE L’EPAVE PORT-VENDRES I
L’agglomération antique de Port-Vendres n’est pas connue (mais Strabon cite un “Portus Veneris”). Quelques découvertes de monnaies et de céramiques ont été faites ponctuellement. Découvert en 1963, puis fouillé en 1973-74, dans le port de Port-Vendres, à l’emplacement de l’actuelle Criée, le gisement se compose d’une épave et d’un dépotoir. Le mobilier de l’épave et du dépotoir ont été mélangés dès l’origine ; puis il a été plusieurs fois déplacé avant d’être rassemblé dans le Dépôt de fouilles de la D.R.A.S.M., à Port-Vendres. La dernière synthèse a été faite par B. Liou1 qui date l’épave autour de 400. 68 monnaies ont été découvertes dont la plus récente est datée de 408 ; la monnaie d’emplanture est datée de 313-317. Le décalage entre les céramiques et les monnaies est important et il semble que les monnaies ne soient pas en place. Le seul matériel dont on soit sûr qu’il appartient bien à l’épave est composé d’amphores Almagro 50 et 5 1C.
Le dépotoir restitue peu ou pas de. céramiques locales dans la catégorie des céramiques communes. On peut donc supposer qu’il s’agit d’un dépotoir constitué lors de débarquements plutôt qu’un dépotoir d’habitats (le matériel résiduel -sig. du sud de la Gaule, arétine) est très largement minoritaire). Cependant, il est quasiment impossible de déterminer une datation précise de ce lot qui pourrait s’échelonner entre le Ve s. et le Vll’ s.
1. La sigillée Claire D (Th. Martin).
Ce mobilier a fait l’objet du mémoire de maîtrise de Th. Martin, en 1974. Ce matériel, parce qu’il présente des exemplaires entiers, est d’une grande utilité pour la typologie. Toute une série d’observations ont ainsi pu être faites sur certaines formes. Du point de vue de la pâte, il s’agit du groupe DI.
Les décors.
L’essentiel des poinçons était déjà connu en 1974. Il semble qu’il y aitplusieurs séries: un premiergroupecomposédedécors anciens, fin IVs., avecunecouronne composée de carrés et de losanges, et un deuxième avec une série de plats plus tardifs, Vls., portant des décors dechrismes, colombes, agneau, etc.
Les formes.
Les formes les plus fréquentes sont les H. 61A et B. H. 76 est une forme difficile à dater : 425-475 pour Hayes avec l’Agora d’Athènes mais Mackensen pense qu’elle apparaît plus tôt. H. 61 pose énormément de problèmes. H. 61A à fond plat: IV’ s. mais également V’s., en pâte Dl classique. H. 61B mal caractérisée : pâte D2, vernis épais, même fabrication que la forme H. 87 (Golfe d’Hammamet). Il existe une forme de transition entre ces deux variantes : H. 61 A/B caractérisé par un bord haut. Hayes date la forme 6 IB de la première moitié du Ve s. sur l’étude stylistique. Cette datation est remise en cause par les archéologues allemands qui trouvent cette forme sur les camps abandonnés du Limes (monnaies) : ils la dateraient de la fin du IV’ s. Michel Bonifay pense qu’elle est plus tardive d’après l’ambiance des contextes provençaux (Marseille, Arles, Clos de la Lombarde à Narbonne) et qu’elle serait à situer à la fin du Ve s. H. 87 : reconnaissable à son pied. Il existe une corrélation entre formes et décors: la forme H. 61A est plutôt caractérisé par une composition A2 et la forme H. 87 par une composition. L. Rivet pense qu’il n’y a aucune équivoque en voyant des formes entières (H. 61B et 87) : ce sont des formes très différentes qui n’ont pas de relation évidentes entre elles. En conclusion, toute la typologie de Hayes est représentés à travers le matériel de Port-Vendres : c’est un tessonnier idéal.
Discussion.
Le problème est au niveau des lieux de production : les différences typologiques s’expliquent “facilement” par des lieux de production différents (pâte, poinçon, composition décorative). Du IVe au VIe s., l’approvisionnement se fait auprès de différents sites producteurs. Hypothèse sur le commerce : un endroit centralise plusieurs produits : on peut donc trouver sur un bateau des produits provenant de plusieurs centres géographiquement très différents. La notion de service en Claire D a été rarement développée (cf. sigillée du sud de la Gaule) - en DS.P., 3 formes montrent une notion de service ; la C5 est un exemple évident de service. Les formes H. 82, 83, 84 et 85 ont des types de lèvre apparentés. L’idée est encore à développer.
2. La sigillée claire C.
Le lot fournit une quantité très importante de formes H. 50, à bord très haut. On note quelques Lamb. 35.
3. La Late Roman C Ware.
Il s’agit d’un petit lot de forme H. 3 dont plusieurs fonds décorés de croix et d’oiseaux. Les décors sont du groupe 3. La datation est à situer fin Ve-première moitié VIe s.
4. Les Dérivées-des-Sigillées Paléochrétiennes.
Quelques objets seulement; on note une forme marseillaise 18 classique avec un décor de palmettes 129, connues, par ailleurs, à Marseille-Bourse et à Saint-Victor, à Saint-Blaise (associé à la croix latine 4243 et avec la rouelle 1027). Le reste du lot est de production languedocienne : L 1 (avec un marli décoré de cercles concentriques), 6 et 18 (3 ex.). La datation est à situer milieu Ve s.
5. La luisante.
Elle est uniquement attestée par quelques fragments : Lamb. 1/3 à décor ocelé.
6. Les céramiques communes.
a. Les céramiques communes importées
On peut dire qu’il s’agit d’une collection étonnante. Les marmites égéennes sont en proportion très importante. Les marmites orientales sont également représentées : à lèvre coupée et à deux anses. Les manches de poêlon cannelé illustrent les productions italiques.
b. La céramique commune africaine
En quantité très importante, la série semble homogène: H. 23B, 196, 197, 181 et 182. Avec d’autres séries trouvées sur les sites intérieurs, il est possible de différencier une évolution typologique pour les H. 197, perte de la notion de gorge; pour les 23B, évolution de la hauteur de la lèvre et de la hauteur de la panse; évolution des bords des couvercles H. 196 qui ont tendance à épaissir; etc. Les autres communes africaines sont représentées par les cruches, marmites et mortiers (cL groupe CATHMA). Des tubes de voûtes ont également été répertoriés.
c. La céramique modelée
Il semble que la céramique culinaire micacée de la région de Fréjus ait également été présente à au moins un exemplaire, sous la forme d’une jatte carénée, type 13 (IVe s.).
7. Les lampes.
Le lot est constitué par des lampes africaines de type Il et, pour une grande part, d’imitatiô-ns dë’lampes africaines.
8. Les amphores.
a. Les amphores orientales.
L’échantillonnage est suffisamment important pour permettre de travailler sur les différences typologiques. D. Piery a passé en revue toutes les catégories et tous les types présents.
- LRA 1 : d’un type différent, dans l’ensemble, de celui de La Bourse. Il y a plusieurs variantes (bandeau plus court simplement un bourrelet pour représenter la lèvre). Les exemplaires sont poissés. Un col d’un type très tarfif (VI-Vlr’ s.) a conservé son bouchon.
- LRA 2 : les exemplaires présentés sont poissés ; il s’agit du type courant (originaire d’Orient et daté à partir du IV’ s.). C’est une amphore lourde et massive qui porte des cannelures plates sur la panse. L’évolution qu’elle subit se reconnaît à un col plus fin, aux cannelures qui changent et qui finissent par se transformer en stries -peignées ; puis, au VII’ s., les cannelures plates reviennent à la mode.
- LRA 3 (Asie mineure) : les deux types sont représentés (Robinson M373 et M307) ; on note également une grande variété de bords (bandeau triangulaire, très court, etc.).
- LRA 6: origine syro-palestinienne; globulaire, cannelé sur toute la panse; deux très petites anses attachées sur la panse. - Amphore de Gaza : le type précoce comme le type tardif sont représentées. - A côté de formes très connues, on trouve toute une série de petites amphores qui sont à rapprocher éventuellement du type Robinson M 273, avec de nombreuses variantes, des pâtes très différentes. Ces exemplaires sont poissés. Ces formes (pour certaines) ont été rencontrées à La Bourse.
b. Les amphores africaines.
- Lot relativement abondant de “Keay IIIB sim.”, probablement une variante tardive du type Africaine I.
- Africaine II.
- Amphores cylindriques de moyennes dimensions : 80 % sont poissées; typiques du IV’ s., elles sont aussi connues au V’ S. - Spatheia classiques : poissés (dans l’épave Dramont E, elles transportaient des olives).
- Keay XXXV B : typiques de la première moitié-milieu du V’ s.
- Keay.XXVII et Keay XXXVI: formes très voisines : l’une est plus pansue que l’autre (V’ s.).
- Dressel 30.- plutôt des amphores III’-IV’ s. (Maurétanie Césarienne).
Les amphores tardives semblent être en très petites quantités : Albenga 12, Keay 57, 55.
-Ostia I, fig. 453 : bien que fabriqués en Tipoliatine, on la trouve également sur des ateliers de Byzacène; ces amphores sont poissées.
c. Les amphores hispaniques.
Elles semblent constituer 90 % de l’ensemble : Almagro 50, 51B et 51C, Dressel 23.
Discussions.
Le problème est le même que pour les claires D, à savoir une même appellation pour des choses différentes. Un autre problème est aussi posé : celui de la bivalence du contenu des amphores.
II. RUSCINO2
R. Maréchal nous présente quelques céramiques provenant du site de Ruscino2. Il n’y a pas de mobilier “Antiquité tardive” proprement dit. Le mobilier présenté est daté des Vlle-VIIIe s. et provient essentiellement de silos, situé sur le plateau où était Ruscino-Ville haute (l’habitat étant une éventuelle ville basse qui a pu s’implanter entre Ruscino et la Têt, en bas de pente, dans une zone de colluvions et dont on est sûr qu’un habitat X’-XI’ s. a pris le relai). Il s’agit de découvertes anciennes auxquelles viennent s’ajouter quelques récoltes plus récentes. L’une de ces fouilles a permis de mettre au jour, récemment, dans un silo, une grande urne à anses et deux tremissis en or (datés de 69 8 et 702/70 1). La céramique présente des formes homogènes, à savoir des umes globulaires avec, très souvent, des cannelures sur le bord de la panse et un fond bombé. Elle a été lissée avant cuisson. Les vases sont souvent déformés et présentent des caractères hispanisants (voire arabisant) certains.
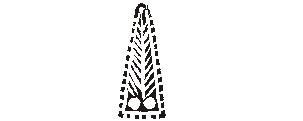
Par ailleurs ont également été trouvées quelques formes entières : une petite
gourde (“grenade”).
Dans les silos, cette céramique est accompagnée de scories. On trouve également
du mobilier résiduel (campanienne, céramique à vernis noir, etc.). Quelques
monnaies ont aussi été mises au jour : 4 ou 5 tremissis en or qui ne sont
en général pas usés.
Pour le verre, D. Foy indique qu’un fragement comparable a été trouvé par
C. Raynaud, en association avec des amphores dont une datable du début
du VllIe s. ; quant aux tiges torsadées, elles sont datées des VIe-VIIe
s. dans des contextes orientaux.
Les silos, qui sont situés à l’extérieur de la zone d’habitat, semblent
correspondre à l’abandon d’une aire d’ensilage très importante. Au moment
de l’abandon, on enterre et les sépultures semblent homogènes et limitées
dans le temps.
Dans le comblement des silos, une centaine de pièces en fer ont été mises
au jour, représentant des rejets d’outils (qui pourrait être soit des récupérations
antiques, soit des outils wisigoths) ; des éléments de tabletterie ont
également été trouvées.
L’hypothèse de R. Maréchal concernant l’occupation tardive de Ruscino est
que le site romain (“Ville haute”) a servi de carrière pour un quartier
bas (établi au bord du passage de la rivière, probablement dès le IIe s.
av. n. è.). Au Ile s. de n. è., Ruscino-Ville haute est plus ou moins abandonné
et la ville basse continue en tant que point commercial.
Au VIIe s., les Wisigoth réoccupent le plateau avec une aire d’ensilage. A la fin du VII’ s. ou au début du VIIIe s., l’aire d’ensilage est abandonnée. Il reste alors une population qui enterre ses morts sur le sommet de la colline à la fin du VIIIe s. Puis le site est totalement désertifié.
III. PERPIGNAN
J. Kotarba nous présente plusieurs sites sur lesquels il a travaillé.
1. Elne-agglomération, “Le Couvent”.
Dépotoir dans une cour de maison, qui correspond au comblement d’un bassin. Une série monétaire composée d’environ 40 monnaies n’a pas encore été étudiée. Il y a un peu de résiduel.
* Céramique commune - elle comprend une série d’urnes à lèvre simple, déjetée
et légèrement biseautée, à fond plat, et
une série de petites écuelles (modelée/toumrnée) aux formes les plus simples
possibles. Quelques marmites.
* Africaine de cuisine deux bords H. 197
à lèvre évoluée.
* Commune importée : un mortier africain.
* Céramiques fines : pas de DS.P. estampées ; une coupe à bord rond de couleur
orange;.une coupe carénée qui se situe entre la véritable DS.P. et la céramique
commnune : c’est une forme courante à Narbonne.
Une série de B/Luisante et d’engobée (on notera qu’il existe dans la région
des ateliers qui produisent des céramiques à vernis argileux non grésé),
représentées entre autres par des tasses à deux anses (3 ex.).
* La sigillée claire D : H. 61A évolué, 59, 60, 67, c’est-à-dire des formes
anciennes également associées à des décors anciens (A2) ; un exemplaire
de mortier avec des grains de basalte qui recouvrent le fond, avec un versoir
à peine suggéré. Une forme problématique : plus ou moins apparenté à la
forme H. 91C (plus tardive), les guillochis qui oment ce mortier appartiennent
plutôt à la forme H. 91 A ou B.
* Lampes : trois lampes plus ou moins entières non identifiées et une imitation
de lampe africaine en pâte très grossière. * Les amphores (peu de formes,
beaucoup de panses) : le lot est essentiellement composé d’amphores hispaniques
(Almagro 5 IC ?, Dressel 20). Pour les amphores africaines, on note le
type cylindrique de la fin du IV’ s. Pour les amphores orientales, un exemplaire
de LRA 3 de type ancien (Ille-IVe s.)
* Le verre : une forme de bouteille, qu’on date plutôt du IVe’ s. D. Foy
pense que c’est un contexte plus ancien que celui du Clos de la Lombarde
à Narbonne.
En conclusion: pas ou peu de DS.P., beaucoup de Luisante; la sigillée claire D ne semblepas dépasser4OO au maximum ; le faciès des céramiques communes ressemble à celui du Clos de la Lombarde.
2. Tautàvel, Los Bonissos.
Prospections sur un site d’habitat, défoncé par les labours successifs. Une quantité importante d’huîtres et de scories de fer a été trouvée. Le mobilier n’est pas en place. - Sigillée claire D : H. 58, 59.
- DS.P. : 2 f. 18 et une petite coupe.
- Céramiques communes à pâte sombre, à pâte très cuite: les formes sont
ovoïdes avec des lèvres en bandeau; deux séries peuvent être distinguées
: un groupe de pots à lèvre simple et un autre avec des lèvres un peu plus
travaillées. A côté de ces pots, une série de petits bols.
- Amphores: LRA 1.
Lors de la publication de l’article3, le contexte avait été daté de la
fin du VIe s. La datation semble trop tardive au regard
de la sigillée claire D.
3. Saint André (au sud d’Elne), site de Sainte-Eugénie.
- Sigillée claire D : variante
Gandolfi.
- DS.P. : f. 1 à faux godrons.
- Amphores : hispaniques (Almagro 5 IB, Dressel 23).
4. Brouilla, Mas Tardieu.
- Sigillée claire D : H. 99, Martin NV
IV.
- DS.P. : orangée, première moitié du V’ s. (faciès du Clos de la Lombarde).
- Céramique commune importée: un bord de mortier africain.
- Céramique commune: un fond décorée imitant la DS.P.
- Amphores: spatheion tardif (VI-VII’ s.).
5. Fourques, Prat.
Prospections sur ce qui pourrait être éventuellement un site d’atelier.
Le mobilier se résume à des fragments en pâte grise fine et en pâte oxydante.
Quelques fragments sont estampés.
6. Canet-en-Roussillon, Pouges del Baja.
Sur un site d’habitat occupé jusqu’au IIIe s., un mausolée tardif (4 tombes en pleine terre et des fragments d’os éparpillés dans le bâtiment très arasé) est implanté sur une partie des lieux, sur le sommet de la colline ; le mobilier céramique provient des pentes.
- Sigillée claire D : H. 99, 104.
- Céramique commune : les formes présentées sont proches mais peut-être
quand même postérieures à celles de Tautavel (lèvre en bandeau, creusée).
7. Elne-Paloll d’Alvall.
Fouillé dans les années 60-70 (R. Grau), il s’agit d’un dépotoir, situé à l’extérieur de la ville, en bordure de la voie domitienne. L’assemblage présenté est un choix de céramiques.
- Sigillée claire D : Fulford 37/40, H. 61A, 67, 99.
- Late Roman C : un fragment.
- DS.P. : productions de Saint-Paul-de-Grossac, Narbonne. On remarque un
couvercle en DS.P. et son imitation en céramique commune locale.
- Amphores LRA 1 tardive ; quelques Gauloises ; Keay 8B, 35A, 55, 61 de
forme bizarre en conclusion, le lot amphorique est génial (sic !) !
La datation du contexte se situe plutôt la fin Ve-début Ve s. (deuxième moitié du Ve s. au plus tôt, première moitié du VIe s. au plus tard.
8. Futur barrage de l’Agly, Camarany, Coudoume 541.
Dans ce petit établissement qui possède une forge (une série de petits couteaux à soie fine, les fers à marquer et le four à réduire le minerai ont été mis au jour), le mobilier céramique se compose de :
- Sigillée claire D : H. 12/102 (deuxième moitié du Ve s.) ;
- Amphores : Dressel 23 ;
- Céramiques communes locales modelées ou réalisées au tour lent, dont
la pâte est très micacée et dont les formes évoquent plutôt la fin de la
production.
Dans cette région, il n’a pas été trouvé de contextes dépassant la deuxième moitié du Ve s. dans les grosses fermes romaines. Les contextes tardifs appartiennent plutôt à des petits sites isolés, sans passé.