|
Téléchargez le fichier PDF |
CATHMA
Compte rendu de la réunion du 14 avril 1994 à Laudun (Gard)
Présents : M. Bonifay, D. Carru, J. Charmasson, D. Goury, 1. Houpin, A.
Leclaire, M. Leenhardt, C. Michel d’Annoville, C. Pellecuer, J.-M. Pène,
D. Piéri, J. Piton, J. Proust, C. Raynaud, J. et Y. Rigoir, L. Rivet, D.
Rouquette, S. Saulnier, J.-C. Tréglia, L. Vallauri.
Excusés : F. Coeur-Mezzoud, G. Demians d’Archimbaud, G. et J.-B. Féraud,
N. Lecuyer, J.-P. Pelletier, C. Richarté, L. Schneider.
Avant d’entamer la séance, D. Goury nous convie à une visite du Musée de Laudun.
Les fouilles récentes réalisées autour du forum du Haut-Empire, près d’une poterne de l’enceinte augustéenne, ont mis au jour une grande fosse à métallurgie riche en scories de fer (Espace 8, sondage 15, US 6/8). A la fin de son utilisation, cette fosse a servi de dépotoir, livrant un abondant mobilier essentiellement céramique. Hormis un lot de poteries résiduelles des occupations antérieures du site, aisément identifiables par l’aspect usé et par la typologie, près d’un millier de fragments concernent l’Antiquité tardive.
Cet ensemble présente deux intérêts majeurs, d’une part l’excellent état de conservation des poteries livrant de nombreuses formes complètes, d’autre part la présence dans la couche d’un trémisse franc à l’effigie d’Anastase, monnaie peu courante, datée de l’année 520 et fournissant un précieux terminus post quem pour la constitution du lot.
L’assemblage céramique se caractérise en premiere approche par la prépondérance des céramiques conununes représentant plus de 75 %, suivies des amphores tandis que la vaisselle fine est presque absente (35 fr. ; cf. graphique). Cette dernière est dominée par la sig. claire D, représentée majoritairement par des types du Ve s. (H 87A et B, 9 1) mais aussi par des types plus caractéristiques du VIe s. (H 97 et 104A). La céramique estampée grise apparaît timidement, avec essentiellement des productions “rhodaniennes” et peut-être un vase d’origine provençale, mais le loi reste peu typé. Quant à la céramique Luisante, elle n’est représentée que par un petit lot de tessons résiduels.
Les amphores s’inscrivent dans la même fourchette et se partagent entre les productions orientales (LRA la, 2a et 5) et africaines (types 62a et 62q).
Par leur abondance (près de 300 vases identifiés), les céramiques communes constituent un ensemble de référence majeur pour la basse vallée du Rhône, venant compléter et étayer les enseignements des fouilles de Lunel-Viel, Pataran et Lombren, avec lesquelles de nombreux parallèles sont possibles. Deux productions sont attestées : les céramiques à pisolithes d’une part, très minoritaires et peut-être même résiduelles, et les céramiques kaolinithiques prépondérantes (plus de 90 %). Celles-ci possèdent un faciès nettement antiquisant où les formes ouvertes sont très fréquentes malgré la domination des vases fermés. Ces derniers sont essentiellement des umes-olloe, d’une typologie bien connue où dominent les bords en bandeau, types KAO A29 et voisins (Typologie DICOCER, cf. Lattara 6), et quelques autres formes comme 1’ume à lèvre aplatie A2 1, ou à lèvre quadrangulaire A19. Une cruche F8 est aussi présente, proportion comparable à ce qui a pu être observé à Nîmes/Rue de Sauve, Lombren ou Saint-Blaise. Les formes ouvertes sont quant à elles dominées par les traditionnelles marmites carénées à lèvre en amande, ici amande effilée du type B32 aux multiples variantes, et par les petits bols hémisphériques B28, aux stries caractéristiques soulignant la lèvre. Ces formes, héritées du Ve s., voisinent avec une innovation, le bol caréné B31 à col haut et bord mince, production appelée à une utilisation plus tardive. Les gobelets cylindriques 16 sont aussi bien attestés.
L’ensemble des éléments de datation livrés par la céramique a été soumis à un essai de datation statistique par le logiciel Typocer mis au point par M. Py (cf. Lattara 5) et donne une fourchette serrée entre 520 et 530. Si le terminus post quem, confirmé par la présence de la monnaie de 520, peut être retenu sans difficulté, il paraît plus prudent d’élargir la fourchette jusqu’au milieu du VIe s. pour tenir compte de la présence des amphores les plus tardives, notamment orientales.
C’est donc un contexte du second quart du VIe s. que nous offre l’oppidum de Laudun, document qui vient à point s’insérer dans la série des lots étudiés en Languedoc oriental mais jusqu’à présent mal servis en éléments de datation. On peut désormais mieux caler les faciès antérieurs aux années 520 (Pataran, Lunel Viel), ceux du second quart (Nîmes/Sauve, Lombren) et ceux postérieurs au milieu du siècle (habitat de Dassargues : cf. CR de la réunion CATHMA du 15 avril 1993 à Lunel-Viel) et ateliers de Masmolène et Bollène-Jonqueirolle). Soulignons en particulier l’absence significative, dans cette série de plus de 150 vases, des bords à crochet interne du type A25, forme produite dans l’atelier de Bollène (Thiriot 1986). Cela constitue un indice précieux pour affiner la datation des céramiques communes au sein du VIe et du VIIe s., périodes pour lesquelles on ne dispose pas toujours de poteries importées.
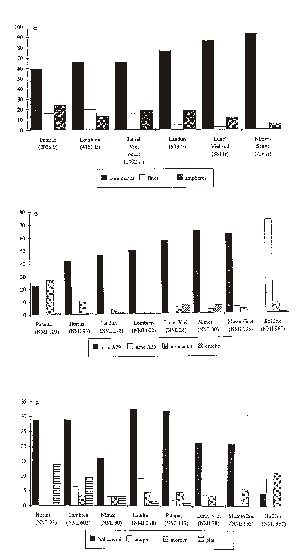
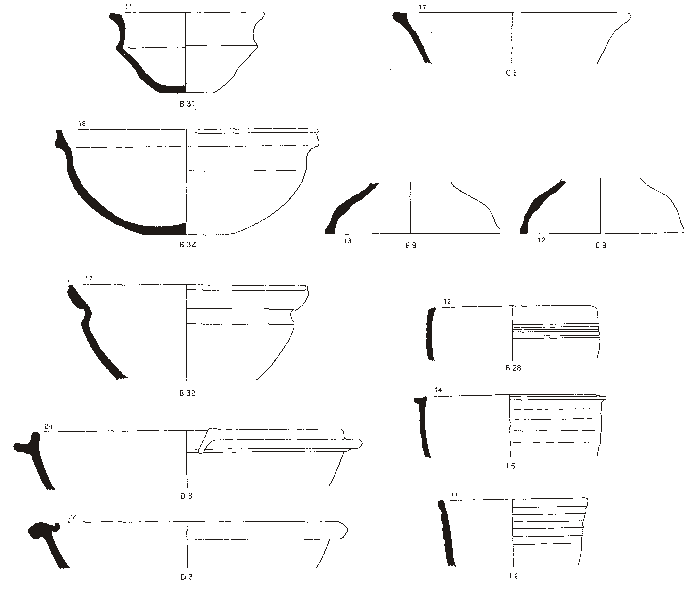
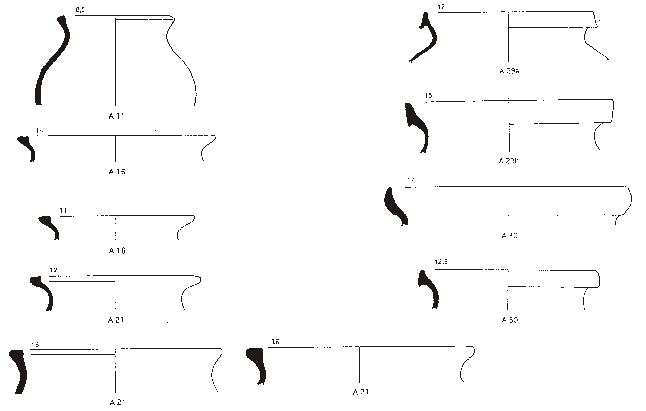
La publication de l’ensemble de Laudun est en préparation.
2. LOMBREN REVISITÉ (fouille J. Charmasson; présentation CI. Raynaud)
La fin de la réunion a été consacrée au réexamen d’une partie du mobilier des fouilles anciennes de l’oppidum de Lombren, qui présente de nombreuses similarités avec celui de Laudun mais s’en distingue par la présence de for-mes plus anciennes et par une plus large fourchette de datation, entre le milieu du Ve s. et le milieu du VIe s. Sur ce dernier site, dont les céramiques communes font l’objet d’une nouvelle étude dans l’article de la C.A.T.H.M.A.-Languedoc (Archéologie du Midi Médiéval, 10, 1993), on relève la présence d’un riche ensemble de céramique estampée grise susceptible de renouveler la définition des faciès régionaux pour la vallée du Rhône.
Cette catégorie, que l’on serait tenté de baptiser “valentinoise” parce que signalée la première fois par A. Blanc à Valence, se distingue des Ab autres productions connues dans la vallée du Rhône par sa couleur généralement gris verdâtre et son engobe qui se desquame par petites écailles. Une forme d’assiette lui est particulière (fig. ci-contre) ainsi que les guillochis arrondis. Des tessons trouvés à Saint-Georges-Les-Bains (Ardèche), quartier de Mars, par E. Durand, portent des empreintes de poinçons inédits qui rattachent bien cette série aux DS.P.
Une visite du site du Camp de César à Laudun a ensuite été conduite courageusement par Dominic Goury, sous une pluie battante et glacée.

Pour la prochaine réunion, les 19 et 20 mai, R.V. à Port-Vendres, le jeudi à 14 h, au pied de l’obélisque (à proximité du port). Présentation du matériel durant l’après-midi ; le lendemain matin, matériels de Ruscino et d’Elne.
M. Bonifay propose de coordonner les choses sur le plan pratique (lui téléphoner au 42.59.26.83).